
@ Céline B. La Terreur
Vidéographe honore ses fondatrices
et fondateurs :
Thérèse Bérubé, Pierre Devroede, Pierre Falardeau, Robert Forget, Jean-Jacques Leduc et Ghislaine Martineau
Soirée-hommage
Le Conseil d’administration de Vidéographe est extrêmement fier d’accueillir Thérèse Bérubé, Pierre Devroede, Pierre Falardeau, Robert Forget, Jean-Jacques Leduc et Ghislaine Martineau au sein de son cercle des Membres honoraires. Cette initiative vise à remercier les personnes qui ont été à l’origine de notre Centre, il y a près de 50 ans, et qui, à titre de membre de l’équipe de Vidéographe ou artiste y travaillant, ont participé au développement de la vidéo au Québec.
L’initiative des membres honoraires a pris forme en 2018 suite à un chantier de réflexion sur le futur de Vidéographe. Au cours de ce processus, nous avons identifié que le Rayonnement, la Recherche, le Partage et la Communauté étaient des éléments fondamentaux de notre mission et de notre devenir. Ces quatre pierres angulaires et précieuses sont la fondation de Vidéographe et brillaient déjà dès son origine. Il nous est ainsi apparu important de reconnaître la créativité, l’audace et l’engagement profond des personnes qui nous ont précédé et grâce auxquelles Vidéographe existe aujourd’hui. Nous remercions chaleureusement nos membres honoraires qui ont accepté cette invitation.
Une soirée de célébrations fut organisée le 27 novembre 2019. Ce fut un événement de retrouvailles exceptionnel comblé d’amour, d’anecdotes savoureuses et d’histoires inspirantes. Au cours de cette soirée, nous avons également annoncé le lancement du Prix Robert Forget, nommé en l’honneur de l’idéateur de Vidéographe, et qui soulignera un apport exceptionnel à l’image en mouvement au Québec.
En 2018, nous avons célébré une première cohorte de Membres honoraires composée de Charles Binamé, Jean-Pierre Boyer, Michel Cartier, Jean-Paul Lafrance, Yves Langlois, Jean-Pierre Masse, Pierre Monat et Tahani Rached.
MEMBRES HONORAIRES 2019
 Thérèse Bérubé était présente dès les débuts de Vidéographe où elle était en charge des relations avec les membres et les usagers. Elle a par la suite suivi une formation de deux ans auprès de Monique Champagne, une scripte réputée de Montréal. En plus de 40 années de carrière, Thérèse Bérubé a joué un rôle important dans le cinéma québécois en travaillant comme scripte sur près de 145 productions, dont une majorité de longs-métrages. Parmi ceux-ci figurent un très grand nombre de films majeurs de la cinématographie québécoise. Les réalisateurs et réalisatrices les plus connus avec lesquel.le.s elle a travaillé sont : Louis Bélanger, Gilles Carle, Mireille Dansereau, Anne Émond, Bernard Émond, Philippe Falardeau, André Fortier, Jean-Claude Labrecque, Micheline Lanctôt, Carole Laure, Simon Lavoie, Catherine Martin, Louis Saia et Denis Villeneuve. ► Lire la suite
Thérèse Bérubé était présente dès les débuts de Vidéographe où elle était en charge des relations avec les membres et les usagers. Elle a par la suite suivi une formation de deux ans auprès de Monique Champagne, une scripte réputée de Montréal. En plus de 40 années de carrière, Thérèse Bérubé a joué un rôle important dans le cinéma québécois en travaillant comme scripte sur près de 145 productions, dont une majorité de longs-métrages. Parmi ceux-ci figurent un très grand nombre de films majeurs de la cinématographie québécoise. Les réalisateurs et réalisatrices les plus connus avec lesquel.le.s elle a travaillé sont : Louis Bélanger, Gilles Carle, Mireille Dansereau, Anne Émond, Bernard Émond, Philippe Falardeau, André Fortier, Jean-Claude Labrecque, Micheline Lanctôt, Carole Laure, Simon Lavoie, Catherine Martin, Louis Saia et Denis Villeneuve. ► Lire la suite
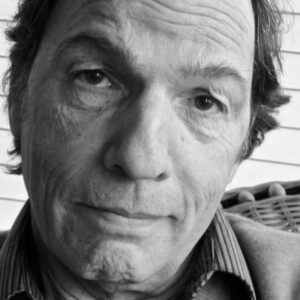
Pierre Devroede a travaillé à Vidéographe dès ses débuts en 1971. Il a participé à la conception du vidéothéâtre et supervisait les visionnements des « vidéogrammes » qui parfois donnaient lieu à des discussions dans le vidéothéâtre. Il veillait à la distribution des copies de « vidéogrammes » pour les télévisions communautaires, les groupes de citoyens et les institutions d’enseignement. ► Lire la suite
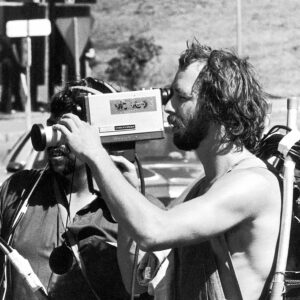
Né à Montréal, Pierre Falardeau (1946-2009) est rapidement devenu un des réalisateurs les plus en vue du cinéma et de la vidéo d’ici. Se familiarisant avec le structuralisme et l’école documentaire québécoise au cours de ses études en anthropologie, il utilise, dès sa sortie de l’Université de Montréal, les moyens de production offerts par le Vidéographe pour réaliser le court métrage Continuons le combat (1971). Son franc-parler, ses prises de position politiques et sociales, de même que ses critiques contre le fédéralisme et l’exploitation coloniale des travailleurs, ont fait de lui un intellectuel des plus colorés. Julien Poulin, un camarade de collège, se joint à lui pour le montage du film À mort (1972). Ensemble, ils réalisent Les Canadiens sont là (1973), Le magra (1975), À force de courage (1976), Pea Soup (1978) et Speak White (1980). S’étant à maintes reprises heurté au refus systématique des programmes d’aide cinématographique des gouvernements, son oeuvre est synonyme de persévérance, de provocation et de dénonciation. ► Lire la suite
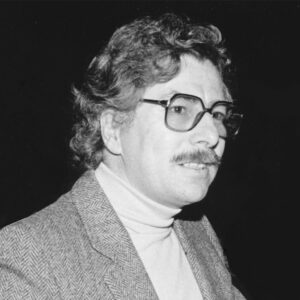
Né en 1938, Robert Forget étudie en biologie et en physiologie. Il réalise des films éducatifs en 8mm dans les années 1960, dont l’un qui lui vaudra de rencontrer Norman McLaren. Il entre à l’Office national du film du Canada (ONF) en 1965 comme directeur de la section des films éducationnels en biologie. Il y participe au Groupe de recherches sociales, avec entre autres Maurice Bulbulian, Fernand Dansereau et Michel Régnier, où se développe l’idée d’un cinéma participatif. C’est dans cette optique qu’il s’intéresse à la vidéo au tournant des années 1970. Il est alors l’initiateur du projet de Vidéographe, qui prend vie en 1971. Il en sera le directeur et l’un des principaux animateurs de ces premières années, avec Jean-Pierre Masse et Jean-Jacques Leduc. Il reçoit en 1973 le prix John-Grierson pour sa contribution exceptionnelle au cinéma canadien. ► Lire la suite
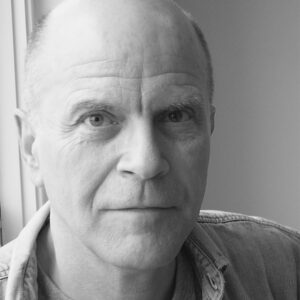
Jean-Jacques Leduc est connu pour son travail à l’Office national du film du Canada (ONF). Il y produit quelques 25 films d’animation, dont la célèbre série Ludovic de Co Hoedeman. Il y réalise également deux films d’animation. En 1981, il cosigne Zea avec son frère, André, lui aussi animateur. Le film remporte le Prix spécial du jury au Festival international du film de Cannes en 1981 et le Génie du meilleur court métrage pour distribution en salles à Toronto en 1982. En 1990, il signe Les miroirs du temps qui regroupe des cinéastes d’animation en mettant à profit les logiciels développés par le Centre d’animatique. ► Lire la suite

Après 15 ans d’expérience à la Banque de Montréal, d’abord comme caissière et ensuite comme responsable du département d’épargne, Ghislaine Martineau a travaillé à Vidéographe comme adjointe au directeur de 1973 à 1975. Au cours de son mandat, elle fut plus spécifiquement responsable de la tenue de livres. Ce passage à Vidéographe fut, je la cite, une expérience mémorable. Elle n’a jamais oublié cette équipe de travail dynamique, créative et chaleureuse ; les artisans au talent débordant tels Pierre Falardeau dans “Continuons le Combat” et Julien Poulin, son collaborateur et ami qui co-réalisa “Le Magra”. Il s’agissait d’une période faste pour la production de documents percutants. Par la suite, elle fit un échange d’enseignant en Angleterre et profita de cette opportunité pour voyager pendant une année. De retour au Québec, elle travailla pour la compagnie d’assurance Chubb – compagnie qui assure actuellement Vidéographe, quel hasard. Elle a la chance d’avoir un fils et deux petits enfants dont elle est très près. ► Lire la suite





